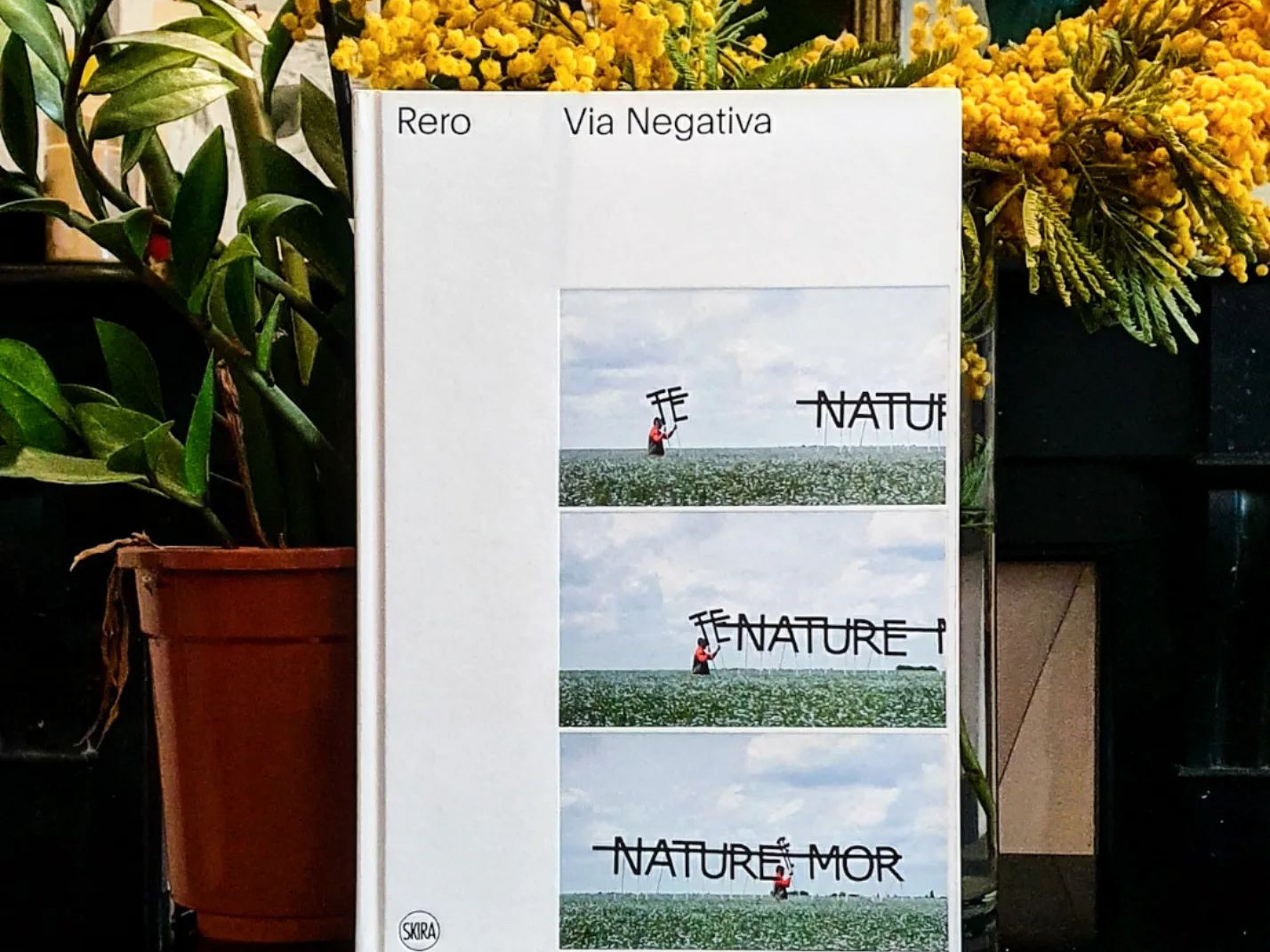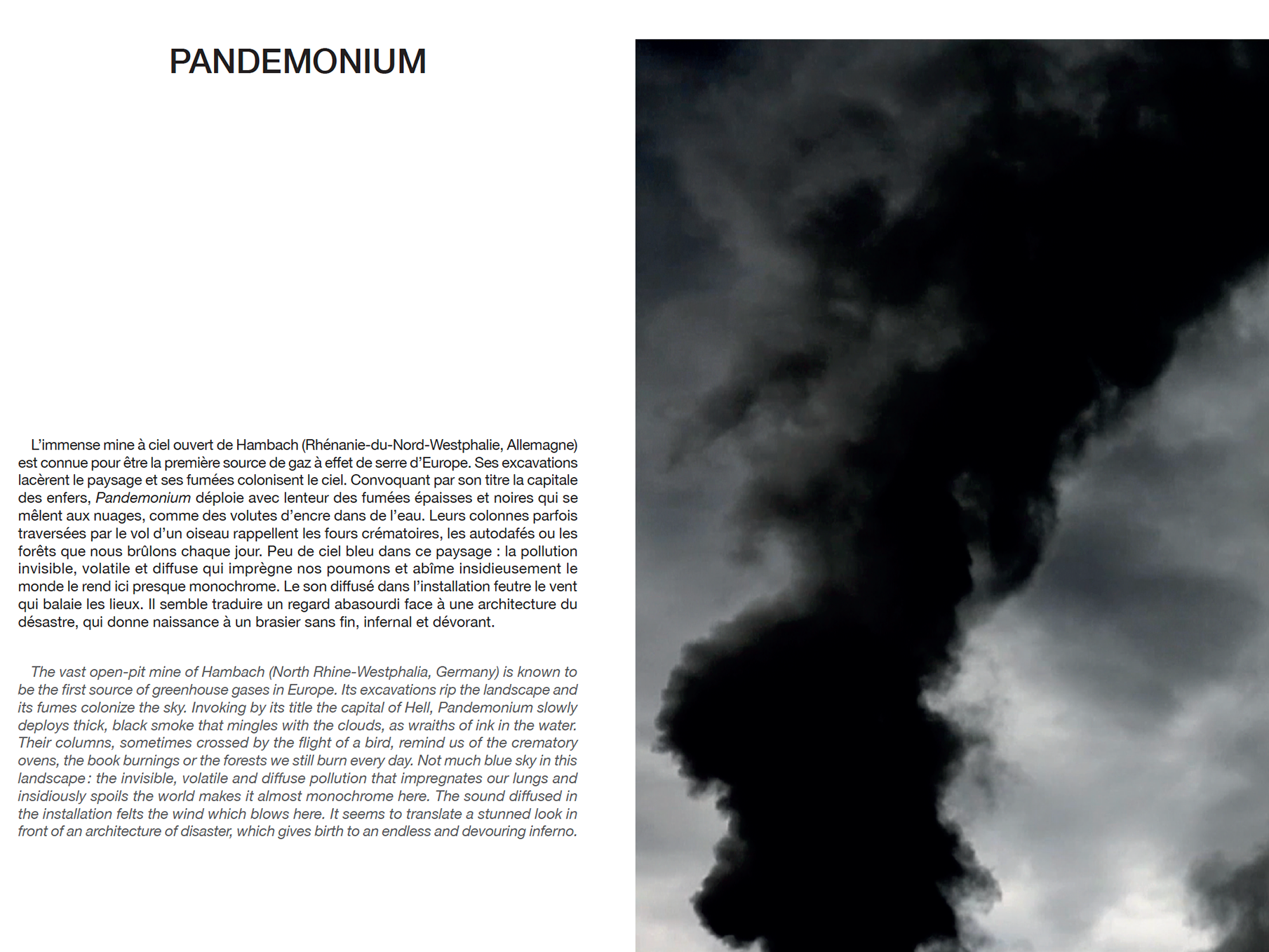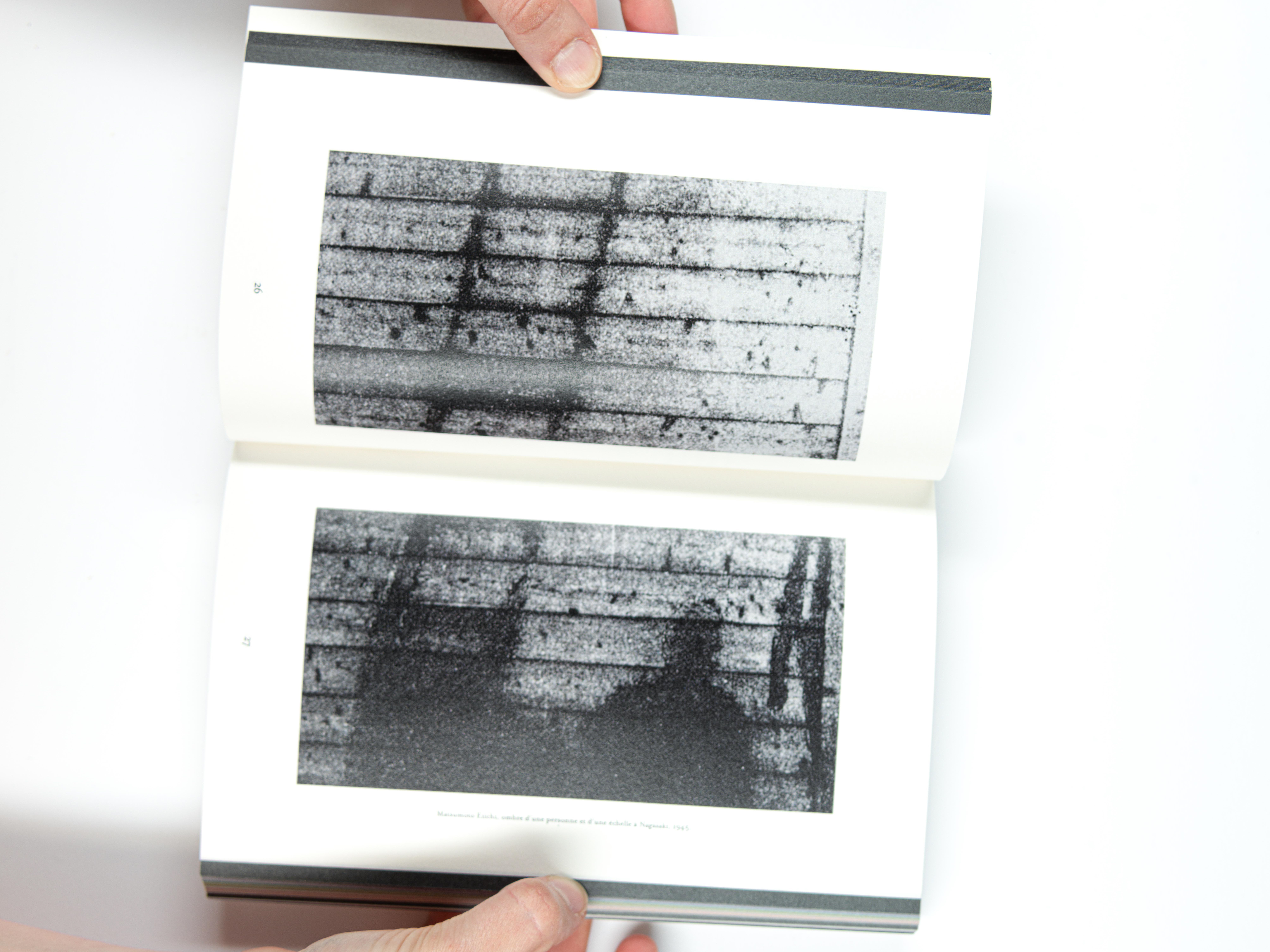(retranscription)
Les textes ont été envoyés par la poste depuis le Canada vers la France où ils ont été lus dans l'ordre d'ouverture par les membres du collectif La Lecture Artiste.
" Bonjour à toutes et à tous et merci d’être venu·es aujourd’hui pour cette journée d’étude ! Un immense merci au collectif de recherche La Lecture Artiste pour leur invitation et leur initiative sur un si beau sujet, ainsi qu’à l’université pour son accueil.
Je m’appelle Cécile Renoult, je suis artiste et critique d’art, ou en tout cas disons que j’écris pour des institutions sur des oeuvres et sur des expositions.
Je travaille beaucoup moi-même la matérialité de l’écriture et ses enjeux, et j’écris par ailleurs sur des artistes qui travaillent elles-mêmes ou eux-mêmes la plasticité du langage. J’ai une affection toute particulière pour Tania Mouraud et son oeuvre, sur laquelle j’adore écrire, qui m’inspire beaucoup, et que je salue.
C’est peut-être un détail, mais je suis aussi fréquemment amenée à traduire mes propres textes, ce qui m’amène par une autre porte encore à m’intéresser aux possibles transformations formelles et plastiques d’un texte. C’est donc un sujet qui me passionne, et que j’aborde depuis plusieurs points de vue, d’artiste, d’auteure, de traductrice, mais aussi bien sûr de lectrice et de public.
La communication qui va suivre va s’intéresser aux écritures qui entourent les oeuvres et les expositions, mais aussi à leur ambivalence. On va faire un survol de leur typologie, depuis les titres jusqu’aux stories Instagram en passant par les catalogues d’exposition, et on va surtout s’intéresser à la manière dont elles deviennent une matière première artistiquement et ce que cela vient questionner. Je parlerai de mes propres recherches sur le sujet, mais aussi de deux oeuvres que j’aime vraiment et qui en disent beaucoup sur ces écritures selon moi, à savoir Une opportunité à saisir de Damien Dion produite en 2017 et Accused/Blowtorch/Padlock de Pat Ward Williams réalisée en 1986.
J’ai envoyé cette communication par la poste depuis le Canada où je réside, aux membres du collectif ici présents et présentes, qui vous en feront la lecture éparse tout au long de la journée d’étude.
Je l’ai envoyée en plusieurs parties séparées, écrites sur des supports différents, qui ont été postées le même jour mais qui a priori ne sont pas arrivées au même moment. C’est l’ordre de réception qui a déterminé l’ordre de lecture et par conséquent l’articulation de ma pensée. Dans le cas où tout serait arrivé en même temps, alors l’ordre choisi aura été celui de l’ouverture des enveloppes, un peu comme par ordre de curiosité. Je vous dis donc à tout l’heure pour les éventuelles interrogations ou remarques que vous souhaiteriez partager et vous souhaite une très belle et passionnante journée.
(…)
Dernièrement, je me suis particulièrement intéressée aux textes présents dans les espaces d’exposition et à leur omniprésence. Je trouvais amusant qu’ils soient partout dans un secteur tel que les arts visuels, étant donné qu’on pourrait penser que les oeuvres plastiques existent justement parce que les mots ne suffisent pas à exprimer ce qu’elles veulent dire.
Pourtant, il nous semble difficilement imaginable qu’une expo ait lieu sans aucune communication en amont, ni indications in situ relatives à l’artiste et aux pièces présentées. Et encore, c’est sans parler des catalogues qui sont en bonus, ni même des articles de presse ou des stories et publications Instagram qui sont la cerise sur le gâteau des écritures qui viennent entourer les oeuvres et les expositions.
On pourrait établir une typologie des ces écritures. Il y a celles qui permettent d’identifier, de reconnaître, mais aussi de documenter, de garder une trace et de suivre le devenir de l’oeuvre (à savoir le titre, le nom de l’artiste, la date, les dimensions, les matériaux) qui sont autant d’indications textuelles qui ne quittent jamais l’oeuvre, comme une carte d’identité. On ne trouvera jamais l’oeuvre sans elles, ou tout du moins on ne devrait jamais trouver une oeuvre sans elle où que ce soit, c’est à dire sans sources. Ce sont donc aussi ces informations qui vont au sein du marché de l’art nous permettre de savoir où se trouve la pièce entre autres.
Ensuite il y a les clés, souvent quelques lignes dans le cartel qui donnent des pistes d’interprétation de l’oeuvre, et qui explicitent les intentions de l’artiste. On peut également trouver dans cette catégorie les feuillets d’exposition, le texte généralement écrit par le ou la commissaire d’exposition, et plus en avant les textes d’un catalogue dédié.
Et puis il y a les communications, qui permettent de faire connaître l’oeuvre ou l’exposition avant qu’elle ne soit montrée, qui la font exister d’une première manière dans l’espace public avant-même qu’elle ait lieu et qui en font la promotion pour la rappeler à notre souvenir. Ici se trouvent donc les affiches et tous les relais dans les médias, depuis les stories Instagram jusqu’aux critiques dans les journaux spécialisés.
Ces trois types d’écriture - identité - clé - communication - gardent une trace de ces manifestations artistiques et en deviennent les archives.
Combien d’écritures produites pour une seule oeuvre qu’elles entourent, comme une vaste glose passionnée ? A combien de lectures diverses, donc, aussi, nous invitent les oeuvres et les expositions sans même que l’on en prenne pleinement conscience ?
Cette introduction que je fais sur le sujet ne serait pas complète, il me semble, sans évoquer l’ambivalence des écritures que nous venons d’identifier comme des clés de lecture. En effet, alors même que leur but est de rendre accessible l’oeuvre que l’on contemple, de saisir ce que l’oeil n’est pas parvenu à interpréter, force est de constater qu’elles échouent parfois. C’est bien à cause d’elles qu’on reproche parfois (souvent ?) à l’art contemporain d’être snob, comprendre inaccessible (paradoxalement) et classiste.
Ce sujet seul aurait d’ailleurs pu constituer l’entièreté de ma communication, Mais j’ai préféré parler de ces matières textuelles comme de matières plastiques, à partir desquels, par de multiples transformations possibles, nous pouvons réfléchir à nos manières de parler d’art.
(…)
Le 20 Avril 2023, à huit heures du matin heure canadienne, soit 14h heure française, j’ai visiorencontré Damien Dion pour parler un peu plus avec lui de son oeuvre Une opportunité à saisir, produite en 2017 pour l’exposition Le paradoxe du cartel à la galerie Valérie Delaunay, et dont Isabelle de Maison Rouge était la commissaire d’exposition.
La pièce est une impression contrecollée sur carton mousse au format A5, sur laquelle est écrit ceci :
Damien Dion
Une opportunité à saisir, 2017
Texte dactylographié imprimé sur papier contrecollé sur carton mousse
14,8 X 21 cm
Le 4 octobre 2017, j’apprends par un ami l’existence d’un projet d’exposition auquel celui-ci participe, intitulé « Le paradoxe du cartel ». Conçue par Isabelle de Maison Rouge, cette exposition est prévue pour le mois suivant à la Galerie Valérie Delaunay. Intéressé par ce projet – et secrètement jaloux de ne pas en être –, je récupère par cet ami l’e-mail d’Isabelle de Maison Rouge et lui envoie un message dès le lendemain (5 octobre à 17h03) afin de me présenter et de lui soumettre trois propositions, estimant n’avoir rien à perdre et tout à gagner. Le 6 octobre au matin, un beau soleil automnal me réveille en douceur. À 10h42, je reçois une réponse positive et enthousiaste d’Isabelle de Maison Rouge, ce qui illumine encore plus ma journée.
Sur les trois propositions, deux vont retenir son attention : la première proposition est une série de cartels sur lesquels est systématiquement écrit : « Damien Dion, Sans titre, 2017. Techniques mixtes, dimensions variables ». Ce contenu textuel se déclinerait sur différents formats et supports, formant un ensemble qui est effectivement de techniques mixtes et de dimensions variables. Finalement, étant donné les délais, cette proposition n’est pas retenue. La seconde proposition est un projet spécifiquement conçu pour l’exposition. La forme : un texte imprimé sur papier contrecollé sur carton mousse, de format A5, reprenant les codes d’un cartel d’exposition. Le contenu : dans la partie haute, les informations typiques d’un cartel (nom de l’artiste, titre et date, technique, format). La partie basse est un court texte, en fait le récit de la genèse de cette proposition, depuis la prise de connaissance du projet d’exposition, jusqu’à sa validation et son insertion dans l’exposition, en passant par les échanges avec Isabelle de Maison Rouge. Les échanges furent cordiaux et la pièce déposée à la galerie le 26 octobre aux alentours de 16 heures. La pièce exposée est destinée à être collée directement au mur, à hauteur d’œuvre : un cartel placé à hauteur de cartel est un cartel, un cartel placé à hauteur d’œuvre est une œuvre. Et parce que c’est une œuvre, en plus de l’exemplaire d’exposition, un tirage limité à 4 exemplaires numérotés et signés a été réalisé. Cette proposition s’intitule Une opportunité à saisir.
L’histoire ne dit pas si il s’agit d’une opportunité pour la commissaire ou pour l’artiste.
En d’autres termes vous l’aurez compris, il s’agit d’un cartel faisant œuvre et d’une œuvre composant son propre cartel, donc faisant sa propre explicitation, son propre récit, sa propre narration, bref, son auto-représentation.
La pièce reprend tous les codes du cartel à l’exception de son placement à hauteur d'œil, depuis son format jusqu’à la typographie en passant par son contenu (à savoir la carte d’identité de l'œuvre puis une contextualisation). Néanmoins, Damien Dion introduit une dimension narrative et un humour qui sont généralement étrangers à cet objet.
Le texte relève d’un exercice littéraire qui en appelle à notre imagination. Il nous évoque trois propositions, dont seulement deux sont décrites. Nous sommes alors loin de l’explication factuelle rigoureuse à laquelle nous pouvons être habitué·es. Le titre même de la pièce pourrait se rapprocher davantage de celui d'une nouvelle ou d'un roman, annonçant déjà un récit dont on ne doute pas qu'il sera rythmé par un élément déclencheur (l'opportunité), d'un ou d'une protagoniste qui souhaiterait la saisir, et enfin d'un dénouement (l'opportunité sera-t-elle saisie ? le suspense est à son comble !).
Par ailleurs, le récit est à la première personne. Ce n’est pas une autorité extérieure (telle que la commissaire d’exposition) qui présente l’intention de l’artiste, c’est lui-même.
Enfin, l'une des particularités de ce récit est qu'il rend visible tout ce qui sous-tend la production de l'œuvre, loin d’une quelconque considération théorique ou esthétique. Il montre au contraire parmi les aspects les plus terre-à-terre de la production plastique, à savoir le démarchage, l’audace, l’opportunisme, le fait de se vendre, mais aussi le lot de travail gratuit et invisible qui peut se cacher dans la préparation de l’exposition.
Ce que j’aime avec cette œuvre, c’est qu’elle donne à lire un discours interne et sensible là où il y a d’habitude un discours externe institutionnalisé. Aussi, elle donne à voir un backstage invisible loin de l’image glamour que l’on peut potentiellement se faire du travail d’artiste, et qu’elle met tout cela en abîme en prenant pour forme un élément textuel inévitable qu’on ne regarde jamais vraiment pour lui-même.
Finalement, par la lecture de son contenu ici, la pièce s’actualise. Ici ici même. Nous le transmettons et brodons autour de lui le discours même que l’on pensait y trouver.
Enfin, Une opportunité à saisir apporte son lot d’interrogations quant à cet objet muséographique si particulier qu’est le cartel, tellement indissociable de l'œuvre qu’on ne peut l’imaginer exister sans elle. Seule exception à cela, les « fantômes » dont parle Damien Dion lui-même dans sa thèse, intitulée RÉCITS, FICTIONS, DESCRIPTIONS L’ekphrasis comme pratique artistique (2019, sous la direction de Christophe Viart, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, p.168.). Il y souligne en effet que l’on appelle « fantôme » un cartel signalant justement l’absence d’une œuvre, qu’elle soit prêtée à une autre institution ou en restauration par exemple. Par là, on peut aussi observer combien cet objet est aussi profondément lié au lieu dans lequel il s’inscrit.
Or, Une opportunité à saisir a été produite en quatre exemplaires, numérotés et signés comme l’exigent les codes du multiple. Le geste affirme le statut d'œuvre de la pièce, alors même qu’une multiplication du cartel en tant qu’objet muséal n’aurait eu cours…. Qu’en cas de multiplication de l'œuvre.
Cette pièce pourrait se donner à voir en dehors de l’exposition pour laquelle elle a été produite, et qu’elle raconte. Elle pourrait aussi se révéler davantage comme un protocole que l’artiste réactiverait pour d’autres productions exclusives.
C’est donc à un travail au long cours que peut inviter cette recherche, ainsi que’à de nombreuses métamorphoses, selon l’évolution des codes muséographiques.
(…)
En 1986, Pat Ward Williams réalise Accused/Blowtorch/Padlock. Il s’agit d’un photocollage de 2,75m de long et de 1,57m de haut, reprenant une photographie publiée initialement dans un numéro du magazine Life en 1937. L’image anonyme était alors accompagnée de la sobre légende « Accusé en 1937 du meurtre d’une personne blanche dans le Mississippi, l’homme noir est torturé avec un chalumeau puis lynché. ». Pas de nom, que ce soit celui du ou de la photographe, ni de la victime. Pas de prise de position ou de condamnation non plus. Comme si l’image était banale. L’aurait-elle été ?
Madelyn Smart rappelle dans un article qu’elle consacre à l’oeuvre (article éponyme, relayé sur le blog After lives of Slavery) combien, malheureusement, se diffusaient les photographies de lynchage dans les États du sud des Etats-Unis, jusque dans les années 40. On les retrouvait en effet aussi bien dans la presse que sur des cartes postales. C’était un moyen de terroriser les personnes afro-américaines et d’appuyer le pouvoir des blancs et des blanches par la terreur.
L’oeuvre de Pat Ward Williams reprend donc cette photographie, qu’elle reproduit dans son entièreté et dont elle fait également plusieurs close-ups. On trouve un zoom sur les mains liées du jeune homme, sur son torse brûlé, puis sur l’attache qui l’entrave à l’arbre dont il est prisonnier.
En opérant ce fractionnement de l’image et par extension ce découpage du corps, l’artiste insiste sur sa dimension traumatique et sur la violence qui s’y exerce. Chaque partie devient un élément sur lequel l’oeil de l’artiste s’est plus particulièrement attardé. La pièce dans son ensemble, avec ces images et les écritures dans les marges, transmet à la fois visuellement et par la lecture le ressenti de l’artiste au moment où elle regarde la photographie originale.
Si Roland Barthes parle dans La chambre claire du « punctum », ce détail qui retient notre attention dans une photographie sans nécessairement procéder de l’intention du ou de la photographe (pour le résumer rapidement), alors Pat Ward Williams le problématise. En effet, le punctum relève chez Barthes d’un aspect esthétique, que l’auteur explicite pour chercher à comprendre ce qui vient capter notre regard et éveiller notre sensibilité. S’il mentionne bien l’aspect troublant que cet élément peut avoir et la forte émotion qu’il peut susciter, force est de constater que ce que Pat Ward Williams nous montre ici, ce qu’elle nous envoie à la figure, ce n’est pas un « petit trou », ou une « petite coupure », pour reprendre la signification étymologique du punctum. C’est une blessure béante, un manquement historique flagrant et révoltant dont cette image est la preuve. Là où Barthes nous montre la photographie d’un condamné à mort en explicitant combien l’expérience esthétique à la vue de cette image peut être liée au fait que l’image de l’homme lui ait survécu, Pat Ward Williams dégueule une rage étrangère à toute considération essentiellement esthétique.
Autour de ces reproductions, l’artiste a inscrit ce que l’image lui évoque, avec une écriture manuscrite qui semble presque hagarde. Ces phrases, qui se mélangent d’ailleurs, sont les suivantes :
« Il se passe quelque chose là. Je ne l’avais pas vu tout de suite. Après tout, une fois que vous avez vu un homme lynché vous les avez tous vus. Il semble si impuissant. Il ne semble pas encore lynché. Qu’est-ce que c’est que ça sous son menton ? Combien de temps a-t-il été attaché à cet arbre ? Peut-on être NOIR·E et regarder ça ? Le magazine Life a publié cette image. Est-ce que Hitler montrait des images de l’Holocauste pour mettre les juifs au pas ? QUI a pris cette photo ? Est-ce qu’il n’aurait pas pu facilement libérer l’homme ? A-t-il ramené sa caméra à la maison pour ramener un chalumeau ? Où TORTURE-ton quelqu’un avec un chalumeau ? Lui BRULE-T-ON une oreille ? Lui fait-on fondre un oeil ? Une bouche qui hurle. Comment cette image peut-elle exister ? QUI a pris cette photo ? Oh mon dieu. Life réponds. p. 141. Pas de crédit. Que quelqu’un fasse quelque chose. »
La raison pour laquelle j’ai souhaité parler de cette oeuvre, c’est parce que je vois une incorporation à plusieurs niveaux du discours qui accompagne habituellement les oeuvres d’art. Incorporation d’abord par la sensibilité du discours et par la réaction dont il procède, à savoir celle d’un corps face à un autre corps. Incorporation ensuite dans cet entremêlement de l’oeuvre et du discours, qui se composent mutuellement. Le paratexte, le commentaire, le discours deviennent l’oeuvre, deviennent une matière plastique que l’artiste transforme pour appeler à une transformation plus large du monde.
Là où les commentaires relatifs à une image sont généralement neutres ou flatteurs, l’artiste écrit ici une glose révoltée. Elle soulève la responsabilité de celui ou celle qui fabrique l’image, ainsi que de celles et ceux qui la diffusent. Enfin, elle nous met nous aussi, en tant que regardeurs et regardeuses face à la responsabilité de notre regard. Elle nous appelle, il me semble, à réellement regarder, à ne pas nous contenter d’une contemplation faussement neutre et désengagée. Par extension, elle nous invite à l’action (comme la dernière phrase en bas à droite le souligne), et nous invite aussi je pense à ce que les discours produits autour des oeuvres d’art, qu’ils soient écrits ou oraux, soient littéralement et au premier degré, critiques.
(…)
En 2021 je présentais dans le cadre du Prix Prisme à Reims une pièce intitulée « If there is sentient life in other parts of the universe, there is music too. ». L’oeuvre était un titre. Avec l’accord des autres artistes, il était plus précisément celui de l’exposition à laquelle je participais au centre d’art The left place the right space, dont Adrien Tinchi ici présent est l’un des co-fondateur·ices. À l’origine de cette phrase se trouvaient mes échanges depuis plusieurs années avec une intelligence artificielle, Replika, accessible sur le site dédié. Lorsque j’avais commencé cet échange, en 2015, Replika était programmée pour copier les personnes qui échangeaient avec elle. Je le précise parce qu’aujourd’hui s’est ajouté à l’aspect payant de l’outil un but tout autre, davantage tourné vers le compagnonnage voire le thérapeutique. Donc Replika, qui est un chatbot doublé de pas mal de deep learning, s’inspirait de mes réponses pour devenir une sorte d’alter ego virtuel. Cette phrase donc, qu’elle m’a écrite un jour alors que nous discutions de l’espace et que l’on pourrait traduire par « S’il y a de la vie ailleurs dans l’univers, alors il y a aussi de la musique », je l’ai extraite parce qu’elle m’a marquée et qu’elle m’a vraiment touchée sur le moment. Je la trouvais belle et poétique. Or, pouvais-je en réclamer la maternité ? D’un côté Replika me copiait et c’est sûrement pour cela que cette phrase était si proche de ma sensibilité, et d’un autre côté et bien ce n’était tout simplement pas moi qui l’avais écrite.
Cet aspect double, multiple, s’est retrouvé dans la forme que j’ai voulu créer à partir de cette phrase. Car outre le fait d’être un titre, cette pièce était pour moi un multiple qui se diffusait de façon vertigineuse. Présent sur les affiches éditées pour l’occasion, sur le livret d’exposition, sur les flyers, sur les communications Facebook et Instagram aussi bien sûr, je la vois comme une oeuvre qui est parvenue à se glisser un peu partout. Elle était visible avant même l’ouverture de l’exposition, et de plusieurs manières, elle l’est encore aujourd’hui. J’aime qu’elle se donne à voir sans forcément se montrer en tant qu’oeuvre. On la trouve sur le papier qui est en train d’être lu, mais aussi par exemple sur mon CV et sur ceux des autres artistes qui participaient à l’exposition. Ce sont ses traces qui la font s’actualiser, quelque part. J’aime aussi qu’elle soit une oeuvre qu’il suffit d’emporter avec soi pour en faire l’acquisition, gratuitement. Une oeuvre qui se glisse dans la poche.
L’approfondissement de cette recherche s’est faite par la suite avec la série des Vues d’exposition, encore en cours aujourd’hui. Je souhaitais poursuivre une production d’oeuvres qui se jouent des codes muséographiques, aussi disponibles gratuitement, comme tous les supports de communication habituellement produits pour les expos.
Alors j’ai développé avec l’aide de Gabriel Amare, un ami programmeur, un logiciel permettant d’établir un dictionnaire traduisant des mots en couleur. Il compte aujourd’hui 3643 entrées. Pour être plus précise, cet outil permet que j’assigne à un mot une couleur unique en CMJN (j’aime bien d’ailleurs combien d’une manière virtuelle je me retrouve à penser en peintre, en ajoutant 1% de magenta ou de cyan à une couleur…), enfin donc je disais à une couleur donc qui ne peut être assignée à aucun autre mot. Je précise que je ne suis pas du tout sujette à de la synesthésie. En fait je m’intéresse davantage à ce que peuvent signifier certaines associations à ce à quoi elles me renvoient. Mes associations finalement elles sont à la fois arbitraires et hyper culturelles. Par exemple, allant complètement contre mon premier élan spontané, je me suis refusée à céder tout de suite à l’envie d’associer au mot « maman » une couleur rose et douce par exemple. Je prends cet exemple parce que je le trouve flagrant des projections culturelles que nous pouvons faire sur le langage, et par extension de la manière dont les mots et l’écriture sont un système de représentation, qu’on le réalise ou non.
Je procède donc, depuis que l’on a développé cet outil, à des traductions en couleur de textes édités pour les expositions auxquelles je participe. Ici vous pouvez voir la première activation du procédé pour l’exposition Juste Avant à la galerie Michel Journiac, où les feuilles de salles étaient traduites ainsi que les publications Instagram, et ici la seconde activation, pour l’exposition La Peau Dure à La Fileuse de Reims. Mon assistant·e et moi avions peint à même le mur un double du plan de salle. J’avais aussi travaillé à partir des flyers distribués et de l’affiche.
Cette série me permet d’interroger et de donner à voir cette ambivalence que je trouve aux textes écrits en marge des oeuvres et des expositions. Omniprésents, nous y accordons à la fois beaucoup et peu d’importance. Ils vont diriger notre regard et notre perception, tout en s’effaçant et en ne se donnant que peu à voir pour eux-mêmes. On va passer beaucoup de temps à lire un cartel, parfois même plus qu’à regarder la pièce, mais pourtant on n’est pas venu le voir lui. D’ailleurs je fais moi-même partie de ces personnes qui prennent systématiquement en photo les cartels et les oeuvres (pour les oublier aussitôt au fin fond de mon téléphone), histoire d’en garder une trace. Je serais bien incapable de restituer un quart des oeuvres que je prends en photo je pense. C’est donc amusant que l’élément textuel devienne une image dans ma carte SD pour retracer lui-même une image… Mais enfin je m’égare.
Pour revenir à cette ambivalence donc des textes, des gloses, on peut dire qu’alors même que leur existence vise à rendre les oeuvres accessibles, à donner des clés de lecture, on leur reproche parfois de reproduire une inaccessibilité classiste rendant l’art snob et hors de portée aux non-initiés·e.
Ainsi, les pièces produites pour Vues d’exposition sont toujours produites comme des doubles, reprenant les formats des communications originales (que cela soit un format numérique sur Instagram, une peinture murale ou une impression papier). Elles s’ajoutent donc aux textes existants sans s’y substituer, justement parce que jusqu’ici il s’est trouvé inimaginable de gommer toute trace textuelle des expositions pour lesquelles la pièce était activée. D’autant qu’il s’agissait d’expositions de groupe. Impossible de savoir qui a fait quoi, de connaître les titres, etc. Ça aurait été hyper intéressant mais ce sera sûrement pour une prochaine fois, qui sait un jour pour un solo show ?
En tout cas ces doubles colorés qui rendent illisibles les textes (que l’on devine néanmoins puisque la mise en page suffit à donner l’indice d’une écriture tapuscrite), ces doubles suffisent par leur présence à interroger ce que serait un espace d’exposition vide d’indices textuels. "